« Gravity, Cuaron fils de Tarkovsky | Page d'accueil | Natacha Vas-Deyres : « Derrière la science-fiction française, il y a une réflexion politique » »
vendredi, 08 novembre 2013
Lionel-Edouard Martin : « La poésie doit transformer la chose vue en musique »
« Il n'est d'écriture que dans un ressenti particulier de l'univers, où les mots appellent, au-delà des êtres et des choses, un monde épuré de substance, où les corps sont de gloire et tiède la pierre – abolies frondes et catapultes. »
Lionel-Édouard Martin, Brueghel en mes domaines
Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres et malgré une reconnaissance critique indéniable vous demeurez quasiment inconnu du grand public. Comment expliquez-vous cela ?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première serait de dire que je n'écris pas pour le grand public. L'autre raison est que je publie dans des maisons d'éditions qui, sans être confidentielles, sont moins distribuées que certaines autres maisons de plus grande importance. Sur la vingtaine de livres que j'ai écrits il doit y avoir pour moitié des romans, qui sont ce qu'ils sont. L'autre moitié on peut les appeler des poèmes s'il l'on veut. Moi j'appelle ça des proses poétiques courtes. La poésie actuelle en France est peu lue, méconnue, les maisons d'édition peinent à faire connaître les auteurs. Évidemment, on peut citer quelques poètes contemporains qui ont une petite notoriété auprès du grand public. À côté de ce qu'on peut appeler « les grands ancêtres », comme Yves Bonnefoy, les gens de ma génération sont un peu méconnus.
Cela est-il dû à la rigueur et la richesse, peu communes, de votre prose ?
 C'est toujours difficile pour un auteur de se prononcer par rapport à cela. J'aurais tendance à dire que je ne sais pas écrire autre chose que ce que j'écris. Je n'ai pas envie d'écrire autre chose que ce que j'écris. Cela ne pose pas, a priori, d'état d'âme. Cela en pose, en revanche, pour mes éditeurs quant aux retours sur investissements [rires]. Pour un auteur c'est tout de même un souci que certaines maisons d'édition acceptent de prendre le risque de publier ce qu'il écrit. Toute la question est là. J'ignore si c'est à cause de la difficulté de mon écriture qui tranche un peu par rapport à d'autres écritures contemporaines sans doute plus simples ou plus faciles à lire. Aujourd'hui on aime une écriture plus compacte. Mais ce n'est pas pour autant que tous les auteurs se conforment à cette espèce de moule que l'on veut imposer, c'est-à-dire sujet/verbe/complément et c'est tout. Il semblerait que cela soit plus facile à lire, qu'un certain vocabulaire pauvre doive s'imposer s'il l'on souhaite toucher un public plus large. Moi je ne sais pas faire cela. J'ai besoin d'avoir un vocabulaire précis. Le français est une langue riche autant faire avec. Certes, en employant une métaphore musicale on pourrait me demander : pourquoi ne pas jouer de plusieurs instruments ? Le flûtiste que je suis répondrait : il faut quasiment toute une vie pour maîtriser toutes les possibilités d'un instrument. Par exemple, si l'on veut passer au jazz il y a des sonorités improbables que l'on découvre par soi-même. Pour la langue française c'est la même chose. On peut s'en servir de façon simple mais on a un instrument d'une telle richesse qu'on pourrait l'exploiter et le découvrir de toutes autres façons. Je ne vois pas pourquoi un joueur de jazz devrait jouer des mélodies simples.
C'est toujours difficile pour un auteur de se prononcer par rapport à cela. J'aurais tendance à dire que je ne sais pas écrire autre chose que ce que j'écris. Je n'ai pas envie d'écrire autre chose que ce que j'écris. Cela ne pose pas, a priori, d'état d'âme. Cela en pose, en revanche, pour mes éditeurs quant aux retours sur investissements [rires]. Pour un auteur c'est tout de même un souci que certaines maisons d'édition acceptent de prendre le risque de publier ce qu'il écrit. Toute la question est là. J'ignore si c'est à cause de la difficulté de mon écriture qui tranche un peu par rapport à d'autres écritures contemporaines sans doute plus simples ou plus faciles à lire. Aujourd'hui on aime une écriture plus compacte. Mais ce n'est pas pour autant que tous les auteurs se conforment à cette espèce de moule que l'on veut imposer, c'est-à-dire sujet/verbe/complément et c'est tout. Il semblerait que cela soit plus facile à lire, qu'un certain vocabulaire pauvre doive s'imposer s'il l'on souhaite toucher un public plus large. Moi je ne sais pas faire cela. J'ai besoin d'avoir un vocabulaire précis. Le français est une langue riche autant faire avec. Certes, en employant une métaphore musicale on pourrait me demander : pourquoi ne pas jouer de plusieurs instruments ? Le flûtiste que je suis répondrait : il faut quasiment toute une vie pour maîtriser toutes les possibilités d'un instrument. Par exemple, si l'on veut passer au jazz il y a des sonorités improbables que l'on découvre par soi-même. Pour la langue française c'est la même chose. On peut s'en servir de façon simple mais on a un instrument d'une telle richesse qu'on pourrait l'exploiter et le découvrir de toutes autres façons. Je ne vois pas pourquoi un joueur de jazz devrait jouer des mélodies simples.
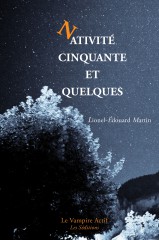 Est-ce également dû au fait que vous ne souhaitez pas vous mêler au spectacle médiatique littéraire ?
Est-ce également dû au fait que vous ne souhaitez pas vous mêler au spectacle médiatique littéraire ?
Oui et il y a plusieurs raisons à cela. Je vis en Martinique la plupart du temps car j'y travaille. D'autre part, je ne vois pas trop la nécessité de me montrer en public. Quel sens cela peut-il avoir ? On fait parfois de merveilleuses rencontres dans certaines librairies (je pense notamment à la librairie Coquillettes à Lyon, où c'était un plaisir et un bonheur de rencontrer les propriétaires de l'époque) car on a un auditoire choisi. Mais je ne suis pas élitiste quand je dis ça : ce sont des gens qui s'intéressent à une certaine forme de littérature, qui sont conviés, qui viennent et cela donne une soirée de qualité sans être collet monté, ni guindé, mais simple et drôle. Ce sont donc des choses que je fais volontiers mais je le fais rarement. J'aime autant qu'on lise mes textes, ça me semble plus intéressant que de m'exposer en public.
Vous êtes un infatigable voyageur, vous parlez plusieurs langues, les lieux que vous parcourez inspirent et imprègnent votre poésie. Mais le plus récurrent et le plus doux des voyages est celui que vous faites en vous-même, vers l'enfance.
En effet, cela correspond à deux facettes de mon œuvrette (pour éviter d'employer le terme « œuvre »). Sur l'écriture courte je fais très souvent référence aux choses vues, aux paysages. On voit quelque chose, on ne sait pas comment ça marche, mais on transforme en mots, presque de façon immédiate, la chose vue. À un moment il y a un déclic qui se fait, une association entre ce qu'on voit et ce qu'on peut en dire. Pour le roman c'est différent, on est dans une écriture plus longue qui ne peut pas être dans l'instantané de la chose vue. Le monde contemporain n'est pas vraiment une de mes récurrences. Ce n'est pas que je le fuie mais je ne sais pas ce que je pourrais en dire. En revanche, je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai vécu une enfance et une adolescence heureuses, celles des années 1960, dont je m'inspire très volontiers. Je dis toujours que je n'ai pas d'imagination car les souvenirs ne sont pas imaginaires. C'est assez drôle car mes parents lisent mes ouvrages et de temps en temps s'exclament : « Mais, où est-il allé prendre ça ? Tu te trompes complètement, ce n'était pas du tout là, ce n'était pas à cette époque ! Etc. » Il y a donc une déformation des souvenirs par une sorte d'imaginaire, ce que j'appellerais une invention involontaire.
Loin d'être cérébrale, votre poésie est sensible. La ripaille bienheureuse que vous chantez ouvre l'appétit. Une réminiscence de la cuisine de votre enfance ?
Oui et non. J'ai toujours eu une grand-mère qui cuisinait. Vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale on était dans une relation à la nourriture qui était marquée par le besoin de manger. Dans les campagnes, là d'où je viens, il y avait un rapport à la nourriture un peu oublié aujourd'hui. Ce fonds de souvenir est très présent. D'un autre côté, et j'espère que cela ne se voit pas physiquement, je suis quelqu'un qui aime la nourriture, la bonne chère. J'aime cuisiner parce que c'est matériel : choisir le produit sur le marché, acheter la matière brute (la viande, les légumes...) et à partir de cette matière on fait quelque chose. C'est ce qui est fantastique dans la préparation de la nourriture : prendre des ingrédients épars, les réunir et en faire un plat (si possible bon).
Finalement, la littérature c'est un peu de la cuisine. On va chercher ce qui nous semble bon : on fait un choix de mots, de rythmes, d'images, etc. et on réunit tout ça pour faire des phrases. Mais je ne suis pas un gros mangeur, c'est-à-dire un gros lecteur. Je ne lis pas quinze livres par semaine. Je fais une sélection de ce que je peux lire, de ce que je sais pouvoir lire et je déguste. Il doit y avoir un plaisir lent à la lecture. Il y a une dégustation à certains styles : Julien Gracq, Jean Giono, Henri Bosco. Il y a un plaisir articulatoire à la lecture de leurs œuvres. C'est comme une mastication.
Pour Nietzsche la rumination est un modèle de lecture philosophique, la faculté permettant d'élever la lecture à la hauteur d'un art.
Je suis arrivé à un âge (57 ans) où on arrête de se gaver. On ne peut plus se permettre les excès que l'on a pu faire quand on avait vingt ans. Je suis arrivé à l'âge de la relecture. J'aime bien découvrir de nouveaux auteurs (même si parmi les contemporains il y en a peu qui me semblent intéressants) mais je suis surtout un relecteur. J'ai passé l'été dernier à relire certains ouvrages de Giono et de Bosco que je n'avais pas relus depuis plus de trente ans. On se dit que c'est de la littérature pour jeunes alors que c'est faux. Il y a toute une partie de la littérature de Bosco, incroyable de force, qui s'adresse à un public adulte. Malicroix (1948), par exemple, est impressionnant par sa beauté stylistique, par sa trace très sonore, par les thèmes de la nature, de l'île, de la terre, de la culture, du corps humain... C'est un texte magnifique.
On ne lit pas de la même manière qu'il y a trente ans. C'est cela qui est fantastique dans les livres qu'on peut relire. Il y a des livres qu'on ne peut pas relire, dont on ne tirera rien à la relecture. Mais il y en a, des textes que l'on croit très bien connaître, qu'on redécouvre à tous les âges. Par exemple, je suis un proustien convaincu depuis la fin de mon adolescence (je suis tombé dans Proust quand j'avais 17 ans) et Proust est un auteur sur lequel je reviens sans cesse. On prend un des volumes d'À la recherche du temps perdu et on tape dedans, n'importe où, et on s’émerveille de redécouvrir certaines choses. C'est la métaphore du petit pan de mur jaune que Bergotte découvre au seuil de la mort sur une peinture murale.

Où se situe votre œuvre dans le temps ? Nous sommes au XXIe siècle mais vous semblez nostalgique du XIXe et du début du Xxe siècle.
Je vais vous étonner, et cela peut sembler paradoxal, mais je me crois foncièrement moderne. D'une modernité certes différente que celle d'auteurs plus jeunes que moi. Mais, je trouve mon écriture plus moderne qu'on ne le croit généralement. Pourquoi ? Parce que, tout en étant relativement classique de forme, il y a toujours quelque chose qui cloche, qui boîte un peu, qui est là pour apporter une petite discordance. Par ailleurs, je suis un tenant des écrits de rythme. J'ignore si cela est bien perceptible dans ce que j'écris mais, par exemple, la question de la ponctuation intervient constamment. Sans être amateur des musiques contemporaines, je me rapproche plus de certains compositeurs actuels qui travaillent sur les questions de rythme, de leitmotiv, etc.
Il faut aussi tenir compte de la façon dont je compose mes livres. La plupart d'entre eux ne sont pas linéaires. Il y a beaucoup de non-dits dans la structure. Je ne suis pas amateur des romans qui guident, qui disent tout, ça me laisse un peu pantois. Je tends plutôt à aller vers une écriture riche et économique. Économique car on n'a pas à dire l'entièreté du monde quand on écrit un roman. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir une écriture pensée comme économie de narration, même si elle peut parfois heurter parce qu'il y a des choses qui manquent. Il m'arrive, bien entendu, de faire des apartés, des digressions, etc. mais tout cela est pensé par rapport à ce que je veux. Ce n'est pas pris au hasard. Ainsi, si l'on y prête attention, la modernité de mon écriture peut ressortir.
Ce serait cela la musicalité de votre style : le mélange entre classicisme et une certaine modernité ?
Dans un prochain roman qui paraîtra en 2014 aux Éditions du Sonneur je fais justement référence à l'improvisation en jazz, une musique que j'aime particulièrement. La question de la musicalité, de l'accord des accords, travaille mon écriture. C'est une question que je me pose constamment. Je ne sais pas faire autrement. Par exemple, j'ai une obsession qui peut sembler bête : le hiatus. C'est quelque chose que je ne supporte pas, même s'il y en a sans doute dans mes textes.
 Trouvez-vous l'air du temps vicié ? Si oui, où trouvez-vous l'oxygène nécessaire ?
Trouvez-vous l'air du temps vicié ? Si oui, où trouvez-vous l'oxygène nécessaire ?
C'est difficile à dire. J'ai toujours l'impression que les écrivains sont mal à l'aise dans leur époque. C'est très romantique comme idée. Je n'en connais guère – mais cela vient aussi du fait que je choisis les auteurs que j'aime – qui se soient satisfaits de l'atmosphère de leur époque. Prenez Proust, par exemple. Voilà un homme que la vie déçoit, il se réfugie dans une chambre pour écrire. Récemment je lisais le poète et traducteur Armel Guerne qui, dans les années 1970 (ma référence nostalgique personnelle), se déclarait complètement désabusé par rapport à cette époque qu'il ne supportait pas, regrettant celle de sa jeunesse. Moi je suis un peu dans le même regret, pour des raisons sans doute peu valables, car j'ai un peu de peine à trouver mes marques dans le monde actuel. Mais je sais aussi que le discours sur la perte des valeurs n'est pas complètement vrai. Il y a beaucoup de complaisance dans le dénigrement du monde tel qu'il est aujourd'hui. J'ai deux filles qui ont 27 et 31 ans qui ont l'air de se satisfaire de l'air du temps. Elles vivent cela avec beaucoup de plaisir et d'hédonisme. Ce qui est sans doute plus vrai que ce que je peux vivre ou remâcher.
Vous n'êtes d'ailleurs pas réfractaire aux nouvelles technologies (vous travaillez sur ordinateur, vous avez un site Internet, un compte Facebook).
À tel point que je ne sais pas écrire autrement que sur un ordinateur. J'ai un peu de peine avec la graphie à la main. Je trouve que la technologie contemporaine en termes de confort d'écriture est impressionnante. Avant il fallait un dictionnaire à portée de main, un dictionnaire des synonymes, etc. tandis qu'avec les outils contemporains vous avez tout à portée de clic. Je trouve cela fantastique. C'est la raison pour laquelle je n'écris guère sans ordinateur. Tout ce qui touche de façon générale à Internet et à la bureautique contemporaine est un énorme plus par rapport à ce qu'on a pu vivre jusqu'à une époque relativement récente.
À ce propos, sur votre site vous traduisez de nombreux poètes étrangers, notamment antiques. Est-ce le même acte de création que l'écriture de vos poèmes et romans ou cela relève-t-il d'une récréation ? Vous affirmez, par ailleurs et paradoxalement, lire peu de traductions.
Pourquoi ne pas lire de traductions ? Tout d'abord parce qu'il y a des choix à faire. Je ne peux pas tout lire donc je me cantonne principalement à la littérature d'expression française. Et puis par principe, si je ne peux pas lire des textes dans la langue d'origine je me méfie toujours un peu des traductions. Je dis bien « un peu » car on a eu en France d'immenses traducteurs, des gens capables de faire autre chose que de passer d'une langue à une autre, de prendre un texte pour le restituer. On a, en France, une excellente école de traducteurs.
Quant à moi je traduis essentiellement de la poésie. Parce que c'est ce qui m'intéresse et parce que j'estime qu'on traduit souvent mal la poésie. Si on a des vers dans la langue d'origine il faut traduire le texte en vers même si cela implique de trahir quelque peu le texte original. Alors c'est certes une récréation mais surtout une recréation et je considère, encore une fois à tort ou à raison, que quand on est soi-même « poète » (mettez une infinité de guillemets) on se réapproprie le texte. C'est une grande tradition française. Par exemple, Paul Valéry a traduit Les Bucoliques de Virgile. C'est une bonne traduction mais c'est du Valéry. Ou alors Claudel traduisant Eschyle : ce n'est plus Eschyle c'est du Paul Claudel ! Certes, on est là pour restituer « la voix de » mais je crois qu'il y a aussi une part d'appropriation. Cela tient aussi à la connivence que l'on peut avoir avec un auteur. Personnellement, je ne traduis que les auteurs que j'aime, ceux qui correspondent à une résonance personnelle. Dès lors que cette connivence entre deux auteurs, distants de plusieurs siècles, s'établit elle doit passer par la restitution du texte tel qu'on le fait en français. C'est un point de vue qui peut se discuter. Je ne suis pas un traducteur professionnel et ne suis pas tenu de traduire selon des considérations commerciales. Je traduis pour le plaisir. Libre ensuite de lire ou pas mes traductions, je ne les impose à personne.
Tout écrivain a un rapport autobiographique avec ses écrits mais votre démarche se démarque nettement de l'autofiction contemporaine.
C'est un sujet complexe que celui de l'autofiction. Je me demande si on n'a pas inventé un genre qui a toujours existé. Évidemment ce n'est pas exactement ce que je fais. Si cela signifie partir de soi-même, de sa propre histoire en la romançant un peu, j'ai l'impression que c'est ce que tout écrivain a toujours fait. Cette espèce de rupture que l'on veut plus ou moins installée entre l'auteur et sa narration me semble assez suspecte. Je suis quelqu'un qui a été très marqué par la psychanalyse, enfin du peu que j'en connaisse, et la critique universitaire dont elle s'inspire a cette tendance à montrer comment, même dans des œuvres où l'auteur semble très distant vis-à-vis de son sujet, combien, finalement, la présence de l'écrivain est toujours bien réelle.
Donc l'autofiction... Pourquoi ? [rires] Elle semble être dans toute œuvre donc je ne vois pas pourquoi on a inventé un genre. C'est peut-être une invention de la critique universitaire mais j'ai l'impression qu'on a nommé quelque chose qui a toujours existé. Nécessairement tout récit et tout roman relève d'une sorte d'autofiction. C'est ce que je disais tout à l'heure : je ne sais pas où se trouve l'imagination pure, j'ignore comment la chercher. On est toujours travaillé par un imaginaire, par une récurrence d'images et de thèmes, et je ne vois pas comment on peut s'en extraire. Vous en faites quoi ? Vous les prenez comment ? Vous vous en débarrassez comment ?
Cela me fait songer à un auteur intéressant, Charles Moron, un universitaire des années 1950 qui avait créé un courant qu'on appelle la psychocritique. Il s'attachait à démontrer, à partir d’œuvres très disparates, une unité de la récurrence des mythes personnels qui traversent toute l’œuvre de certains auteurs (Mallarmé, Baudelaire, Racine...).
 Les auteurs morts ont-ils votre préférence par rapport aux auteurs actuels ?
Les auteurs morts ont-ils votre préférence par rapport aux auteurs actuels ?
Pas vraiment. Parmi les auteurs contemporains que je cite volontiers, les mêmes noms reviennent fréquemment. Par exemple, Pierre Michon qui est un grand écrivain contemporain, même si je n'aime pas tous ses textes également. Jean-Marie Dallet, un auteur d'une beauté à couper le souffle, qui a un coup de patte extraordinaire dans sa façon de recréer des mondes, d'inventer des personnages, tout cela tenu par un phrasé très caractéristique, c'est très beau. Ou encore Emmanuel Ruben, un jeune auteur ayant écrit récemment Kaddish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu, un texte magnifique.
Outre la littérature et la poésie, êtes-vous curieux d'autres arts ? Vous avez évoqué le jazz. Qu'en est-il du cinéma, de la photographie, la peinture, etc ?
Je vais vous dégoûter car je sais que vous êtes cinéphile mais le cinéma est, pour moi, un art mystérieux. Je n'y comprends rien, ça m'ennuie. Je ne vais, pour ainsi dire, jamais au cinéma ou je n'y vais plus. J'ai eu une phase à une époque lointaine mais aujourd'hui non, j'ai arrêté. Très sincèrement, les rares fois où on a essayé de m'y traîner, je m'y suis ennuyé. J'ai toujours l'impression qu'on est dans une forme d'outrance. Mais je dois me tromper. [rires]
En revanche, ce qui m'intéresse davantage, c'est la peinture, contemporaine en particulier. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la chose vue (vous allez vous dire « décidément ! »), dans l'immobilité, dans quelque chose qui raconte forcément, tout en ne racontant pas. C'est, je crois, la meilleure métaphore de la littérature. Après tout, qu'est-ce que la peinture ? Ce n'est pas le motif qui fait le tableau mais bien plutôt le coup d’œil sur les choses. Un peu comme la photographie. La peinture pousse à l'extrême cette question du regard que l'on porte sur les choses. Je crois finalement que la littérature c'est un peu pareil. Ce n'est pas tant le thème qui va être traité mais la façon dont on voit ce qu'on raconte, qui est traduite par un style, par des images, par une écriture. Je dirais la même chose pour la musique.
Dans la musique on est dans quelque chose de complètement immatériel. La musique ne pense pas ! La musique n'a pas de sens. On s'est amusé, en particulier au XIXe siècle, à vouloir décrire la nature par la musique mais on a désormais arrêté. En somme, il y a la mélodie d'une part et l'orchestration par derrière et au moyen de techniques il convient de faire quelque chose qui soit plaisant. Produire des sons plaisants à l'oreille est une vieille définition de la musique, j'ignore si elle est toujours valable, mais à partir de cette substance immatérielle il s'agit de produire quelque chose qui soit capable de captiver l'attention d'un auditeur pour lui donner du plaisir. Là encore le rapport avec la littérature s'impose parce qu'on est dans cette logique où ce n'est pas, à proprement parler, ce qui est montré qui est raconté, mais bien plutôt la façon dont c'est raconté. C'est pour cela que, de mon point de vue, ces arts me semblent faciles à lier entre eux.
Vous avez intitulé un de vos derniers ouvrages Brueghel en mes domaines, faisant référence au célèbre peintre belge Pieter Brueghel. Vous souhaitez donner également du plaisir à travers la littérature ?
C'est ce que j'essaie de faire. Je ne sais pas si j'y parviens mais c'est tout à fait primordial. On y revient mais dans la poésie, en tout cas, le but est de transformer la chose vue en musique.
George Orwell aimait à se définir par provocation comme « anarchiste conservateur ». Diriez-vous, dans votre manière d'être au monde, que vous êtes un « humaniste conservateur » ?
Humaniste nécessairement parce que je le suis de formation et je n'arrive pas à m'en dépêtrer. J'ai ingurgité des quantités de textes anciens de par ma formation de latiniste. Humaniste aussi par conviction. C'est un beau propos, la croyance que la connaissance peut bouleverser notre vision du monde ainsi que la croyance en la beauté. Je partage l'amour et l'intérêt que l'on peut avoir pour l'homme, c'est fondamental. Si j'aime aussi les langues c'est qu'elles nous permettent d'aller vers l'autre, de découvrir d'autres cultures et toutes les dimensions humaines qu'il y a derrière. Apprendre une langue c'est apprendre des autres.
Conservateur, je le suis dans ma manière d'être au monde. Je ne suis pas quelqu'un qui apprécie les bouleversements, les changements, tout ce qui cahote, etc. Les tremblements de terre, ce n'est pas pour moi. Je crois aussi que conservateur, on le devient avec l'âge parce qu'on a tous eu dans une existence antérieure, quand on était plus jeune, une propension à la révolte et à la révolution, mais ça passe avec l'âge et avec une certaine forme de conformisme qui s'établit. On finit par se marier, par avoir des enfants, une maison, même si on s'était juré de ne jamais se marier, d'avoir des enfants et une maison. Donc je suis conservateur d'une certaine manière par rapport à cela.
Mais il ne faut pas prendre le terme au sens politique. Je serais bien en peine de me situer sur l'échiquier politique à l'heure actuelle. De fait, j'ai l'impression de partager le point de vue de bien des Français. Nous ne sommes plus vraiment dans un monde d'idéologie comme ce fut le cas lorsque j'avais 20 ans avec ce choc entre les deux grandes puissances, le capitalisme/libéralisme et le communisme/marxisme, et le peu de marge entre les deux. Aujourd'hui, il me semble que le marxisme n'a plus bonne presse en termes politiques. Nous sommes dans un système où il n'y aurait guère qu'une voix, celle du libéralisme, qui serait soi-disant audible. Au-delà, il y a bien les écologistes mais cela me semble parfois virer à l'extrémisme et je n'aime pas qu'on me contraigne. Je n'aime pas qu'on m'empêche de fumer ou de boire, par exemple. En bon citoyen je trie mes déchets, j'évite de salir, etc. Mais je ne me reconnais pas dans ces discours.
Finalement, votre véritable sujet c'est la langue, le commencement de tout.
Certes, au début était le verbe. Ce qui caractérise l'homme ce n'est pas le rire c'est la langue. Les animaux n'ont qu'un langage qui n'est pas structuré de la même façon que la langue. Ce qu'on appelle la double articulation du langage (d'un côté la pensée et de l'autre la traduction de ces concepts avec des mots) n'existe que dans la langue. Les hommes parlent des langues, les animaux ont des langages. Si être humaniste c'est croire quand même à l'être humain, cela veut dire nécessairement s'intéresser à la langue. C'est pour cela que je suis devenu linguiste de formation. Dès lors qu'on écrit il semble nécessaire de s'intéresser à la langue en tant que telle. C'est un matériau. C'est le moteur même de mes poèmes et de certains de mes romans. Cela est moins perceptible dans le roman car il y a un autre fil conducteur, la narration n'est qu'un prétexte. Ce qui me semble le plus prégnant dans ce que j'essaie d'écrire c'est la langue. Très souvent le personnage principal de mes romans c'est la langue. C'est assez vrai dans la plupart des textes que j'ai pu écrire. Cela se perçoit peut-être plus dans La Vieille au buisson de roses.
Pour rester dans ce thème de la langue, quel regard portez-vous, en tant qu'écrivain mais aussi universitaire, sur la réforme de la ministre Geneviève Fioraso introduisant davantage d'enseignements en anglais à l'université ?
À l'heure actuelle l'enseignement supérieur est un marché et la réforme a pour but d'attirer le plus grand nombre d'étudiants étrangers dans nos universités. On a actuellement une clause qui stipule que pour venir étudier en France, tout étudiant doit savoir parler français et doit le prouver, ce qui limite les flux d'étudiants étrangers en direction des universités françaises. Donc d'un point de vue politique je comprends très bien quels sont les enjeux de cette réforme. D'autant plus que la loi Toubon, disposant que les cours doivent être enseignés en français, n'est pas toujours respectée.
Mais je me situe sur un autre plan, celui de la défense de la francophonie et, d'une façon générale, de toutes les langues telles qu'elles sont parlées de façon actuelle. Il existe encore cinq mille langues, beaucoup disparaissent parce qu'elles sont avalées par d'autres langues. Cela a toujours été le cas mais j'aurais tendance à batailler en mettant en œuvre une écologie linguistique qui vise à la protection des langues qui sont encore parlées. Je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour le maintien de certaines langues qui sont en déperdition. Ne serait-ce que sur le territoire français, il me semble important de défendre les langues régionales. On pleurerait sur la disparition d'une espèce animale et pas sur celle d'une langue ? Toute langue véhicule une culture et avec la disparition des langues ce sont les cultures qui ont tendance à disparaître.
Pour en revenir à la question initiale, le risque est celui de n'avoir, par facilité, plus que des cours en anglais à l'université. Je ne crois pas qu'on en arrive là mais on peut quand même se demander si on ne met pas la main dans un engrenage d'où il ressortirait que le français ne sera plus parlé à l'avenir. Je pense que le français a encore de belles années devant lui mais sera-t-il parlé dans cinq ou six cents ans, ça je n'en sais rien. Ne donner que des cours d'anglais à l'université c'est donner bien de primauté à cette langue. Pourquoi ne pas ouvrir l'université à d'autres langues qui seront sans doute moins pratiquées mais demeurent d'une certaine importance ? Il se trouve que j'ai vécu en Allemagne et je trouve déplorable qu'en France il n'y ait plus beaucoup d'élèves qui apprennent l'allemand. La relation franco-allemande, si importante, passe aussi par la maîtrise des langues. On va au-devant, pas d'une catastrophe sans doute, mais d'un dépérissement progressif.

Vous semblez entretenir une forte complicité avec votre compère Marc Villemain. Pouvez-vous nous parler un peu de lui et de votre goût partagé pour la littérature et le bon vin ?
Marc Villemain est un ami. L'histoire de notre rencontre est complexe. Il se trouve qu'il est d'origine poitevine, et il avait chroniqué un de mes premiers romans qui eut un petit retentissement critique. Puis nous nous sommes retrouvés sur les réseaux sociaux et il avait continué à s'intéresser à mon écriture. De son côté il est également romancier : son dernier livre Ils marchent le regard fier est un très beau texte. Il fallait qu'on se rencontre. Comme il est parisien, et je le suis aussi à l'occasion, on s'est rejoints pour boire un verre, puis deux... On est devenus amis presque instantanément car il y a beaucoup de connivence entre nous. Marc est quelqu'un qui, d'une certaine manière, me ressemble dans sa vision du monde, même s'il est plus jeune que moi. Nous sommes désormais de vrais complices. À telle enseigne d'ailleurs, que nous publierons bientôt un livre à quatre mains. Ce n'est pas un roman ni un essai, ce sont deux voix alternées qui parlent de notre relation au monde de façon générale. Le titre provisoire est Bout de gras : ce sont des discussions à bâtons rompus se déroulant dans mon jardin, sous un arbre. Cela peut donner un joli petit livre.
Je crois aussi que nous avons cette même relation à la nourriture. Marc et moi partageons cet amour du pain. C'est quelque chose d'important car il y a un plaisir à la mâche comme il y a un plaisir à la mâche de l'écriture. Mais c'est, je pense, le cas de beaucoup d'écrivains. Proust, par exemple, nous livre la recette du bœuf aux carottes, c'est une métaphore de l'écriture construite comme un tableau, c'est très beau. Dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs il se livre à des descriptions succulentes de légumes. Le rapport à la nourriture est là, bien présent, même si Proust lui-même se nourrissait d'une biscotte et d'une tisane. Parmi tous les écrivains que je connais, tous sont, non pas des mangeurs, mais des gens qui s'intéressent à la nourriture. Par exemple, Antoine Emaz, considère que faire la cuisine est très important pour un poète. Il ne cesse de le dire. Le rapport à la nourriture est terrible.
Vous retrouvez la même chose chez quelqu’un que j’aime bien, qui est aussi un ami : Xavier Houssin, journaliste au Monde. Chaque fois qu’on se rencontre c’est à Paris autour d’un verre de blanc, toujours au même café, Le Sauvignon, qui porte bien son nom. Xavier est quelqu’un qui aime bien manger, il a un potager et une relation à la matière qui passe nécessairement par la nourriture.
Il semble que vous êtes plus enclin à la création à la campagne. Vous semblez plus à l’aise chez vous que dans le tumulte urbain.
Je suis nécessairement un homme de ville parce que Fort de France n’est pas très amusante a vivre, c'est une ville on l'on peut rapidement s'ennuyer, on est dans un univers très urbain, c’est très compact. J’y vis par nécessité professionnelle. Il m’arrive cependant d’être Parisien. J’aime bien être à Paris pour ne pas y travailler, pour y aller un petit peu en villégiature. Mais foncièrement je suis un campagnard. Je suis né dans une sous-préfecture de 7000 habitants dans le Sud de la Vienne. J’y vis très bien. J’y ai toute mon enfance, et ma famille. Il y a un luxe que l’on peut se payer à la campagne, c’est celui de l’espace.
Je suis incapable d’écrire dans le bruit. Certains écrivent dans des cafés, avec de la musique, etc., mais moi j'en suis incapable. Il me faut une concentration absolue. La vertu principale de la campagne en plus du calme réside dans l’espace vital. L’espace habitable me semble très important et je donnerais toutes les villes pour ça.
Boîte noire
-
Le site de Lionel-Édouard Martin ;
-
pour commander le prochain ouvrage de Lionel-Édouard Martin, Nativité Cinquante et quelques, c'est ici ;
-
le site des éditions du Vampire Actif ;
-
le blog culturel et littéraire du Vampire Actif : Le Vampire Re'Actif ;
-
Claude Aufaure lit Anaïs ou les Gravières ;
-
le site de Marc Villemain.
Sylvain Métafiot
Photos : Jeanne Frank
14:31 Publié dans Actualité | Tags : lionel edouard martin, lecture, nativité cinquante et quelques, claude aufaure, poésie, jazz, nourriture, matériel, musique, littérature, sylvain métafiot, vampire actif, marc villemain, emmanuel ruben, lyon, enfance, gracq, giono, bosco, pierre michon, proust, à la recherche du temps perdu, bergotte, guerne, valéry, claudel, eschyle, les bucoliques, traduction, autofiction, kaddish, moron, humaniste, conservateur, fioraso, toubon, martinique, latin, emaz | Lien permanent | Commentaires (2)










Commentaires
Monsieur,
Quelle émotion de vous rencontrer par l'intermédiaire de facebook ! et qu'elle magnifique appréhension encore discrète de votre art littéraire et poétique. !
Je vais me rendre bien vite sur votre site et y mettre ma curisité .
Je vous remercie de ce clin d'oeil du jour ..
Tous mes compliments et ma reconnaissance à venir, à vous.
Cordialement. Elisabeth Saussard
Écrit par : Elisabeth SAUSSARD | dimanche, 10 novembre 2013
Bonjour Elisabeth,
Merci pour votre commentaire et vos louanges à Lionel-Edouard Martin.
Bien à vous.
Écrit par : Sylvain | lundi, 11 novembre 2013
Les commentaires sont fermés.